 |
 |
La communaut�
arabe |
|
|
|
 |
|

|
|
|
Jeune
fille arabe
(CPA - ND Photo n�403 T - Coll. Ch. Attard)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
On
cherchera en vain dans les r�cits des voyageurs de la fin du XIXe
si�cle des descriptions d�taill�es des
diff�rentes communaut�s de la
ville de Sousse. Leur approche reste, pour la plus grande partie d'entre
eux, purement anecdotique et donc centr�e sur les causes d'�tonnements
propres � int�resser leurs compatriotes rest�s en Europe.
Journalistes, �crivains et hommes politiques d�veloppent quant � eux des vues
particuli�rement indigentes et parfois bien �loign�es des fondements
d�clar�s du Protectorat ainsi Jean Louis de Lanessan (1843-1919),
d�put� libre-penseur, franc-ma�on et radical �crit-il dans son
ouvrage "La Tunisie " :
"Ce qui domine en Tunisie, ce n'est pas l'Arabe pur, mais le
Maure , c'est-�-dire un type cr�� par le m�lange , depuis un grand
nombre de g�n�rations, du sang arabe avec celui de toutes les races et
vari�t�s humaines qui bordent la M�diterran�e. Les Maures forment
avec les Juifs, dont l'origine n'est pas moins obscure, la presque
totalit� des populations des villes. Ces deux cat�gories d'indig�nes,
tr�s semblables par les caract�res physiques, ne se distinguent que
par la religion, par les habitudes sociales qui en d�coulent et par le
genre d'occupations auxquelles ils se livrent, les Maures �tant
propri�taires, fermiers et commer�ants, tandis que les Juifs font
partout le trafic de l'argent."
Ces vues simplistes, teint�es de ce que nous qualifierions aujourd'hui
de racisme, n'�tonnaient pas grand monde vers 1880.
Notre intention
n'est pas ici de d�crire ce que furent dans leurs profondes r�alit�s
ces diff�rentes communaut�s mais plut�t de tenter de les retrouver
telles que les per�urent leurs contemporains entre 1881 et 1956.
Comprenant bien qu'en ce laps de temps et fort heureusement les
perceptions primaires des d�buts du protectorat chang�rent. |
|
|
|
|
|
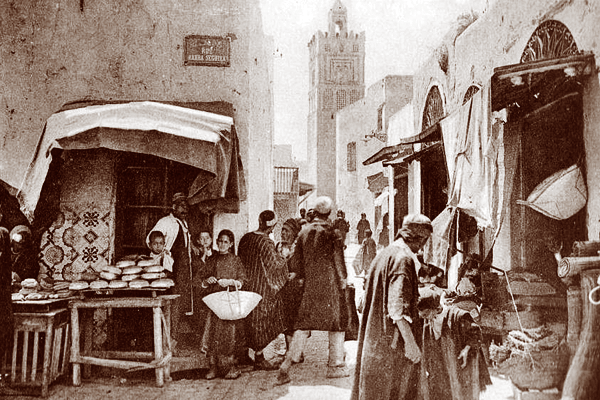
|
|
|
Les commer�ants
de la pace Rahba
(CPA - CAP n�24 - Coll. G. Ellul) |
|
|
|
|
|
La
population tunisienne � Sousse vivait
essentiellement dans la m�dina ou, pour les plus ais�s, dans des
maisons traditionnellement entour�es de jardins (les j�nens) dans les
quartiers p�riph�riques (les r�bats).
|
|
|
|
|
|

|
|
|
Femmes tunisiennes dans leur int�rieur.
|
|
|
|
|
|
Mais tr�s peu d'europ�ens
avaient p�n�tr� dans l'intimit� des familles tunisiennes et leur mani�re
de vivre r�elle �chappait � leurs observations. Seules quelques familles
ais�es avaient laiss� entrevoir leurs lieux de vie au cours de r�ceptions ou
de tr�s brefs reportages.
|
|
|
|
|
|

|
|
|
Une famille
tunisienne.
(CPA - ND n�591T - Coll. Ch. Attard)
|
|
|
|
|
|
Aussi, la grande majorit� des descriptions tient-elle bien souvent plus du
fantasme que de la r�alit�. Nombre de "sc�nes de la vie
tunisienne" virent ainsi le jour et les peintres et photographes
orientalistes recompos�rent des int�rieurs qui ne furent que trop souvent
imagin�s.
|
|
|
|
|
|
 
|
|
|
Tunisiens
ais�s dans leur int�rieur.
(CPA - ND n�203T - Coll. Ch. Attard)
|
|
|
|
|
|
Il �tait d�s lors beaucoup plus ais� de d�crire cette
communaut� par son apparence vestimentaire, son activit�
professionnelle ou religieuse.
Mais l� encore, rare sont ceux qui �tudi�rent tous les particularismes
locaux des costumes par exemple et entr�rent dans le secret de certaines pratiques
inconnues du monde occidental.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les tenues vestimentaires
|
|
|
|
|
|

|
|
|
Dans la rue,
type d'habillement au quotidien ver 1920
(CPA - ND n�10 - Coll. Ch. Attard)
|
|
|
|
|
|
Les hommes �taient, dans leur grande majorit�,
v�tus � Sousse de fa�on traditionnelle, portant la djebba, en soie pour l'�t�, en drap pour
l'hiver, dessous un pantalon court, une chemise et un gilet farmla ou badia,
brod�s pour les plus riches.
Ils sont prot�g�s en hiver par leurs burnous et couverts de la ch�chia.
Cette tenue de base connaissait cependant de nombreuses variantes en fonction
de la profession ou de la position sociale de la personne.
|
|
|

|
Apr�s 1944, de plus
en plus de tunisiens, surtout les jeunes qui fr�quentaient les coll�ges de
gar�ons, s�habill�rent � l�europ�enne. Ils se distinguaient ainsi des
"vieux tunisiens" fid�les � leur tenue et cherchaient �
s'int�grer dans des professions o� ce costume traditionnel aurait
�t� peu appr�ci� de leurs sup�rieurs europ�ens.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quant aux femmes, elles ne sortaient que
voil�es, portant � Sousse un maillot et un ample voile noir, l'adjar leur
enveloppant la t�te et le haut du corps, le plus souvent la Mlahfa noire
�galement les couvre de la t�te aux pieds. Contrairement
aux hommes, cela perdura jusqu�� l�ind�pendance et aux lois sur le
statut des femmes �dict�es alors par le Pr�sident Bourguiba.
Cette tenue noire impressionna beaucoup les premiers europ�ens qui
visit�rent la ville.
|
|
|
|
|
|
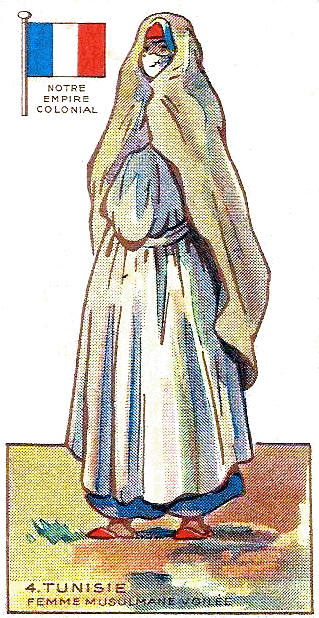
|
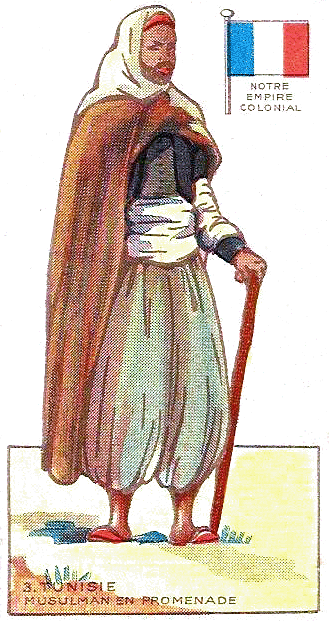
|
|
|
|
|
|
Les femmes citadines de Sousse accrochaient �
leurs oreilles � raison de trois boucles � chaque oreille, 6 boucles.
semblables. Chacun porte le nom d'ounisa et la s�rie se nomme teklila.
|
|
|
|
|
|

|
|
|
Rue de
la Casbah
(CPA - CAD n�22 - Coll. Ch.
Attard)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A noter cependant que les tunisiennes
employ�es, en tant que personnel de maison (femmes de m�nage, gardes d�enfants),
dans les familles europ�ennes, y travaillaient en portant une tenue
simple, avec tout au plus un foulard discret retenant les cheveux.
|
|
|
La nounou de
l'auteur de ce site !
(Coll. Ch.
Attard)
|
|
|
|
 |