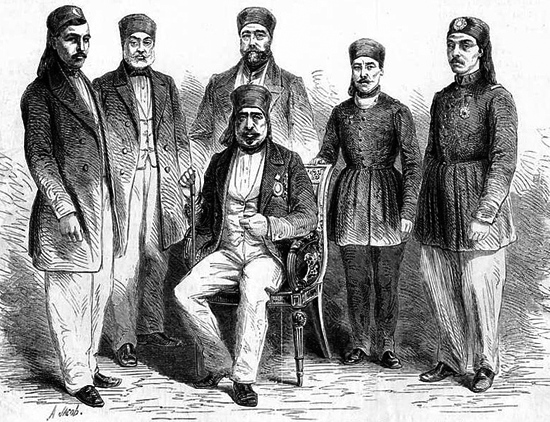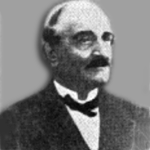|
L'intervention fran�aise |
||||
|
|
||||
|
Le bey de
Tunis, Mohamed Es-Sadok Bey, son premier ministre Mustapha Khaznadar |
||||
|
A la veille de l'intervention fran�aise, la Tunisie est un pays
gouvern� par un Bey et ses mamelouks.
Se souciant fort peu du bien-�tre de leur population, ils surtaxent le
pays : mejba, achour, canoun, caroube (imp�ts directs) mahsoul�ts, droits de douanes sont autant d'imp�ts non �quitablement r�partis
et per�us auxquels vient s'ajouter une pratique abusive de l'usure sur
les plus d�munis. |
||||
|
|
|
|
||
|
Richard
Wood, |
Th�odore
Roustan, |
Licurgo
Maccio, |
||
|
Le
consul de France � Tunis, Th�odore Roustan, conscient des vis�es
italiennes, r�ussit de son c�t� � obtenir la concession des chemins
de fer de la Medjerda en faveur de la Soci�t� de construction des Batignolles
qui la c�de ensuite � sa filiale la Compagnie des chemins de fer
Bone-Guelma. |
||||
|
|
|

|
||
|
Jules FERRY (1832-1893 |
||||
|
Un guerrier khroumir |
|
Des combattants fran�ais |
||
|
|
Mais
le gouvernement fran�ais tergiverse. Sous la pression des milieux
d'affaires, en f�vrier et en avril 1881
Jules Ferry, Pr�sident du Conseil se d�cide � agir pr�textant l�incursion en Alg�rie, en
f�vrier et surtout fin mars 1881, de tribus khroumirs insoumises de la
R�gence de Tunis. |
|||
|
Le g�n�ral Br�art, arriv� aux portes de Tunis, obtint par l�interm�diaire de Roustan, une entrevue avec le bey et lui fit signer le 12 mai 1881 un trait� dit du Bardo par lequel la France garantissait l�int�grit� du territoire et obtenait le droit d�occupation pour assurer l�ordre int�rieur. Ce trait� fut approuv� par la Chambre des d�put�s par 430 voix contre une (celle de Talandier, un d�put� radical socialiste). |
||||
|
|
||||
|
Le Consul Roustan pr�sente le G�n�ral Br�art au Bey. |
||||
|
A la veille des �lections g�n�rales en France, Jules Ferry veut que
l'affaire tunisienne se r�gle rapidement et rappelle la plus grande partie des troupes fran�aises,
15 000 hommes restent sur place. |
||||
|
|
||||
|
Marabouts
pr�chant la guerre sainte. |
||||
|
Le 28 juin le signal de la r�volte fut donn� par le commandant de la place, Mohamed Ch�rif, pouss� par Ali ben Khlifa, grand meneur de toute l�affaire, les plus fanatiques se r�pandirent dans les rues en pr�chant la guerre sainte contre les infid�les. Les Europ�ens du quartier Franc fuirent en prenant place dans des embarcations. Le gouverneur de Sousse, Mohamed Baccouche tente l'apaisement sans succ�s, il essaiera alors que les navires fran�ais bombardent la ville d�s le 15 juillet de faire cesser l'attaque en vain �galement. |
||||